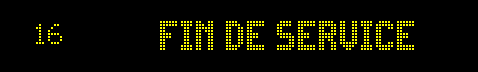Le débat des énergies et carburants est intéressant mais complexe.
Le premier niveau est celui de l'énergie et de la motorisation en analysant plusieurs critères : renouvelabilité, souveraineté, rendement du puits à la roue ou encore cycle de vie complet du véhicule et des installations produisant l'énergie concernée. A grande maille, j'ai retenu les éléments suivants :
Famille des agrocarburants (moteur thermique) :- type biodiesel = peut être produit localement (sinon pas d'intérêt) mais attention à la concurrence des productions agricoles ou encore aux méthodes de production (ex. agriculture intensive et ses multiples effets) / ne règle pas les problèmes d'émission
- type éthanol = presque identique sur la production (mais risque d'import car production depuis canne à sucre et, dans ce cas, bilan mauvais), un peu moins d'émissions mais on n'est pas du tout dans le "zéro émission"
=> Les seuls avantages de cette famille sont de ne pas trop modifier les moteurs actuels. Mais leur mise en œuvre implique la mise en place d'une filière qui est en concurrence avec d'autres... dont les impacts positifs sur la pollution en ville sont plus intéressants. J'ai l'impression que cette famille n'a pas beaucoup d'avenir : on en parle beaucoup (moins maintenant ?) mais dans la pratique, c'est moins simple que ça en a l'air et, en plus, c’est en concurrence avec le reste.Famille des gaz très comprimés voire liquéfiés (moteur thermique) :- GPL = puique issu du pétrole, peu d'intérêt
- gaz naturel fossile = était intéressant il y a quelques années car diminuait beaucoup les émissions par rapport au diesel mais entre les progrès des filtres à particules et le caractère non renouvelable, peu d'intérêt aujourd'hui
- biométhane = produit à partir de déchets locaux résiduels (ex. déchets agricoles bio, restes de l'alimentation type pelures ou déjections), le biométhane présente un bilan intéressant. En valorisant des déchets, on utilise les émissions qu'ils produiront de toute façon pour faire avancer des véhicules avec un bon rapport énergie dépensée / nombre de personnes transportées... et il reste de quoi faire du compost sans problème !

- Hydrogène = On parle bien ici de l'hydrogène dans un moteur thermique, pas avec une pile à combustible / l'avantage est surtout dans une transition vers la PAC (http://www.afhypac.org/documents/tout-s ... pt2014.pdf)... et on n'a pas encore abordé la question de la production d'hydrogène (voir ci-dessous avec la PAC)
=> dans cette famille, je retiens le biométhane ! Mais, dans la pratique, il est extrêmement compliqué de faire aboutir des usines de méthanisation. Évidemment, sans elles...  Famille de l'électrique sans pile à combustible (moteur électrique) :
Famille de l'électrique sans pile à combustible (moteur électrique) :- type alimentation directe par trolleys = probablement le meilleur bilan mais haro sur les LAC !

- type batteries = énormes gains de capacité / autonomie en quelques années mais pas encore adapté aux articulés et lignes avec 300 km de service quotidien + nécessite d'assurer la 2e vie des batteries puis leur recyclage / sur le plan du réseau électrique, en fonction de la production, peut être plus vertueux en pompant en heures creuses (mais tous les critères n'ont pas le même impact donc ça ne suffit pas en tant que tel !)
=> on ne parle pas ici de la production d'électricité mais elle vient du réseau. Hormis les heures de consommation en fonction de l'origine de l'énergie disponible dans le réseau, les questions se posent donc sur un autre plan. La combinaison des trolleys et des batteries avec les trolleybus IMC est évidemment très puissante. Plutôt que la recharge rapide aux arrêts, si on développait les LAC, ce serait top (on s’épargnerait, notamment, des technologies propriétaires) !La pile à combustible hydrogèneEn tant que tel, la technologie est pour l'instant complexe et coûteuse. D'un côté, il faut de l'hydrogène puis ensuite le convertir en électricité qu'on envoie vers une batterie qui, elle, va alimenter un moteur électrique. Si j'ai bien compris, c'est donc une étape supplémentaire par rapport à la batterie... et deux de plus que le trolleybus !

Sur le plan de l'usage, l'intérêt serait donc si à coût volume identique, l'hydrogène était plus efficace que les batteries. Pour l'hydrogène comprimé à 700 bars (véhicules légers), je crois que c'est le cas. A voir pour les poids-lourds où on utilise plutôt la compression à 350 bars.
L'hydrogène n'étant pas présent sur terre à l'état naturel tout seul, il faut l'extraire. Et c'est évidemment là que le sujet devient plus complexe :
Il y a d'abord l'hydrogène dit "fatal". C'est celui qu'on obtient comme résidu lors d'autres réactions chimiques. C'est le cas pour produire du chlore, de l'eau oxygénée ou encore dans les raffineries de pétrole (
https://www.innovation24.news/2020/08/0 ... ut-maitre/). Celui-ci, à court terme, est particulièrement intéressant. Une partie sert à produire des engrais azotés, une petite autre est stockée pour de l'énergie et la dernière est... brûlée... En fonction des coûts de production et revente, l'hydrogène peut devenir, pour ces industries, un moyen de valoriser la filière en réutilisant les déchets. Côté consommation pour le transport, cet hydrogène,
s'il est produit de toute façon et simplement brûlé, ça ne pollue pas spécialement plus.
Il y a l'hydrogène produit spécifiquement pour être réutilisé. Là, tout dépend de la source :
- Gaz fossile -> pas d'intérêt environnemental global
- Biométhane -> d’après l'ADEME, le bilan est intéressant (https://www.ademe.fr/sites/default/file ... 017-06.pdf). Je ne sais pas si cet avis intègre l'ensemble de la chaine de production du biométhane. Mais, sur le principe, on peut être dans une logique de valorisation de déchets à travers du biométhane puis consommation via l'hydrogène. En terme de rendement, on se demande pourquoi ne pas consommer directement le biométhane ? Le seul avantage de passer par l'hydrogène, à mon sens, est de réduire quasiment à zéro les émissions et le bruit sur le lieu de consommation (les émissions sont composées uniquement de vapeur d'eau).
- Electrolyse -> on en a parlé sur le forum. Là, il s'agit de séparer les molécules d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau grâce à l'électricité. Le bilan dépend donc de la production d'électricité elle-même. On est donc dans la logique de concurrence avec les batteries évoquée plus haut. Mais c'est là que ça se complique...
En fait, on le sent venir en arrière-plan de cette synthèse : le bilan environnemental n'est pas seulement lié à la technologie.
Il dépend, finalement, surtout du contexte local.
J'ai suivi, de plus ou moins près, l'avancée de quelques projets. J'ai retenu les éléments suivants.
Le meilleur bilan environnemental est obtenu, de façon générale, dans la proximité entre matière première / producteur / consommateur. C'est comme l'alimentation.

Or, pour diverses raisons, les productions locales peuvent être différentes d'un territoire à l'autre, voire être plurielles sur un même territoire ! Or, les effets de seuil sont importants. A l'échelle d'un réseau, plus le matériel est fréquent, moins ça coûte cher
(sauf si le matériel n'est pas fiable, évidemment...). Il faut donc chercher une certaine homogénéité, au moins à l'échelle d’un dépôt. Or les technologies ne sont pas toutes disponibles à la fois en standard et en articulés ou elles imposent des contraintes différentes. Mais je laisse volontairement cet aspect des choses ici pour me concentrer sur le rapport entre production locale et matériel pour les TC.
Sur un même territoire, j'ai connu deux grand projets de production d'énergie plus propre :
- Un projet d'usine de méthanisation avec des déchets agricoles locaux
- Un projet de quartier à énergie positive (panneaux photovoltaïques) cherchant à valoriser la capacité de production d'électricité pour la rendre disponible ailleurs et à d'autres moments (cf. énergie intermittente)
Ces deux projets avaient besoin de débouchés. Pour le deuxième, c'est l'intermittence qui est en question mais pour le premier, à l'inverse, c'est la linéarité de la production ! Vu les contraintes inhérentes à la production de biométhane, le modèle économique repose sur une usine qui produit toujours la même quantité de méthane. Or, à l'autre bout de la chaine, le rapport de consommation entre l'été et l'hiver est de 1 à 7 ! Pour schématiser, le gaz sert aujourd'hui beaucoup à se chauffer alors que les clims, en été, fonctionnent à l'électricité... La capacité de production de biométhane doit donc se situer sous l'étiage de la consommation de gaz... d'où l'intérêt, pour GRDF, de trouver des débouchés au gaz en été afin de pouvoir augmenter la production de biométhane. D'une part, le modèle économique de l'usine à méthanisation en profite mais, surtout, si ça se fait au détriment du gazole, c'est tout bénef !
Du côté du quartier à énergie positive, il était nécessaire de trouver des débouchés permettant de rendre abordable la production et compression d'hydrogène sur site. Bref, les deux auraient aimé que le réseau TC passe commande ! Quand le réseau ne dispose que d'un dépôt, c'est compliqué...
En terme de modèle économique, le passage au (bio)GNV est abordable lorsque le maximum de la flotte est à motorisation GNV. On rentabilise la station d'avitaillement avec les coûts marginaux liés à l'utilisation d'autres véhicules GNV. La question se pose de la même manière pour l’hydrogène... avec, en plus, un coût exorbitant par véhicule, du fait de la nouveauté.
Le bilan de la motorisation est donc complètement différent selon les contextes locaux. Si on a une usine de méthanisation qui recycle des déchets locaux et injecte le biométhane dans la même boucle que celle qui alimente le dépôt, le bilan est au top. Si on n’est pas dans la même boucle, on peut acheter des certificats d'énergie verte. Mais c’est un peu artificiel... Et si on n’est pas dans la même boucle et qu’on n’achète pas de certificat, aucun intérêt...
Pour l’hydrogène, ça se marrie bien avec l'utilisation d’hydrogène fatal et/ou la rentabilisation d’une solution de stockage d’énergies intermittentes ou, éventuellement, par vaporeformage de biométhane (cf. ADEME). Mais ça me semble moins vertueux que, si disponible, le biométhane injecté dans la boucle alimentant le dépôt équipé GNV (car moins d’étapes et moins de transport).
La conclusion, c’est donc, d’une part, que la meilleure solution doit être adaptée localement et, d’autre part, que plusieurs solutions techniques vont certainement être en concurrence dans les prochaines années. Mettre tous ses oeufs dans le même panier est probablement aussi peu efficace que vouloir courir plusieurs lièvres à la fois. Pas simple...